Bruno Maillé
 Bruno Maillé vit à Eymoutiers depuis une poignée d’années. Après des études de littérature et d’allemand, il enseigna cette dernière matière. De 1997 à 2017, il collabora aux revues L’Atelier du roman et Causeur. Certains de ses articles ont été réunis en mars 2019 dans un recueil publié par les éditions Gallimard (collection Arcades). L’auteur y évoque cinq romanciers, et une artiste, « tous figures essentielles de la modernité », sous l’ombre tutélaire de Frantz Kafka.
Bruno Maillé vit à Eymoutiers depuis une poignée d’années. Après des études de littérature et d’allemand, il enseigna cette dernière matière. De 1997 à 2017, il collabora aux revues L’Atelier du roman et Causeur. Certains de ses articles ont été réunis en mars 2019 dans un recueil publié par les éditions Gallimard (collection Arcades). L’auteur y évoque cinq romanciers, et une artiste, « tous figures essentielles de la modernité », sous l’ombre tutélaire de Frantz Kafka.
Ce sont Pina Bausch, Milan Kundera, Philippe Muray, Philip Roth, Witold Gombrowicz, Günter Grass, que Bruno qualifie de « maîtres de l’imagination exacte ». Titre curieux, qui fleure bon l’oxymore : en quoi ce qui est imaginaire pourrait-il être « exact » ? Ce concept a priori obscur est une création de Bruno Maillé. Pour lui, « l’imagination exacte » est l’expression artistique la plus haute de la réalité : « Le grand art moderne ne fuit aucunement la réalité dans le rêve : il y saisit au contraire l’essence du réel, ce qui est plus réel que le réel. » Pas facile, n’est-ce pas ? Il s’agit tout simplement d’un voyage à la découverte d’un monde fait de « rencontres multiples » (terme cher à Kundera). Rassembler des textes de critique littéraire aussi espacés dans le temps ne nuit pas à la cohérence. C’est plus la forme et le style de l’auteur, remarquable, qui donne sa cohérence à l’ouvrage. Cela parce que le fond n’est pas aussi clair. Un ami fin littéraire me dit même ceci : « Les maîtres de Bruno sont tout simplement ceux qu’il aime. »
Une des particularités de deux de ces maîtres, Muray et Kundera, est d’être des amis intimes de Bruno Maillé. L’expérience vaut la peine d’être contée. Ainsi, de Kundera : Bruno admire cet auteur d’origine tchèque, depuis ses lectures adolescentes. Il osa un jour lui écrire, demandant à le rencontrer. Ce que Kundera accepta, leur entretien donnant naissance à une amitié fidèle et sincère, qui perdure sous différentes formes. Chacune des six personnes évoquées dans ce recueil est représentative d’une facette de l’imagination exacte. Bruno parle de nos dernières décennies comme d’un « désert post-moderne, chaque jour plus aride et inhabitable ». Mais ce monde ne reste jamais aussi désespérant, puisqu’il « reçoit chaque jour le don immérité d’une pluie de beauté, féconde, luxuriante ».
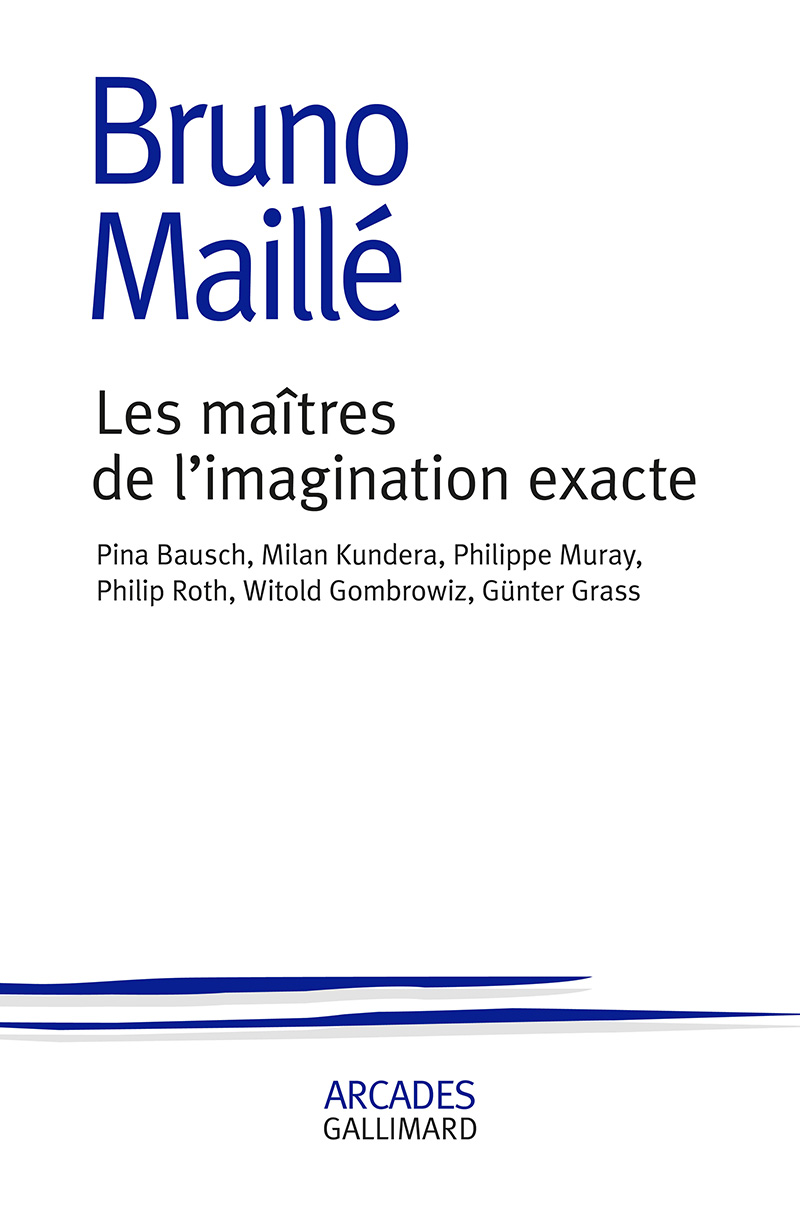 C’est à propos des créations de Pina Bausch, opus de danse, théâtre et poésie réunis, que l’auteur définit son premier maître. Je passerai rapidement sur Roth et Gombrovicz, pour concentrer mon regard sur Philip Muray. La fascination de Maillé pour cet écrivain est paradoxale, et à mon goût, agaçante. Cet écrivain français, mort en 2006, écrivit :
C’est à propos des créations de Pina Bausch, opus de danse, théâtre et poésie réunis, que l’auteur définit son premier maître. Je passerai rapidement sur Roth et Gombrovicz, pour concentrer mon regard sur Philip Muray. La fascination de Maillé pour cet écrivain est paradoxale, et à mon goût, agaçante. Cet écrivain français, mort en 2006, écrivit :
« J’évite, la plupart du temps, d’employer le beau mot de résistance, parce que des tas de salauds en usent et en abusent jour et nuit, mais je sais aujourd’hui que la vie privée est la seule résistance catégorique. » Soit, mais avec ça, ne plongeons nous pas immédiatement dans la réaction ? Révolution plutôt, pense et dit Bruno Maillé. Peu importe, ou plutôt si, lisez donc : « […] déferlement sans frein de l’espèce post-humaine sur des territoires sans cesse plus invivables. » Voilà enfin pourquoi Maillé vénère tant le bonhomme. Lors de ses obsèques, Bruno commença son discours par :
« avec toute la puissance de son verbe et de son rire, Muray résiste à l’immense suicide de l’Occident et de la France dont il est contemporain. » Froid dans le dos, réaction disais-je. De tels propos, et beaucoup d’autres, ont fait qualifier Bruno d’auteur de droite, et pas seulement parce qu’il écrit dans… Je ne crois pas que là soit l’essentiel.
Plus loin, on découvrira en quoi Kundera mérite de recevoir l’étiquette créée par Bruno. Car ce n’est pas ce qui saute aux yeux en lisant Les maîtres. Les articles sur Kundera sont pourtant plus accessibles. Et puis, ce romancier, (presque) tout le monde connaît, au contraire de Muray. À propos du Kundera français, il évoque « un continent exploré, celui de l’art splendide de Kundera ». On est au parfum dès le premier article « Enfin Kundera vint ». Nouveau paradoxe, Maillé évoque ensuite « les fleurs de l’insignifiance », quand Kundera « prolonge la critique du sentimentalisme qui parcourt toute son œuvre ». Dans toute une série d’évocations de romans, essais et nouvelles (ceux écrits en français), Maillé se livre à différents niveaux d’apologie, commençant par évoquer sa première lecture, et les suivantes, ainsi résumées : « le territoire [de Kundera] découvert à 13 ans, je n’ai jamais cessé depuis de l’arpenter, d’y séjourner inlassablement. Je ne suis pas né en France, je suis né dans cet autre pays. »
Pourtant, lire et relire Maillé ne suffit pas à appréhender plus précisément sa fascination, qui me fait penser au travail chirurgical de tel médecin légiste, la comparaison des deux me faisant dire : À quoi bon ? Y a-t-il de la poésie, de la beauté, de l’amour là-dedans ? J’avoue avoir aimé cette méthode chirurgicale, moins les résultats de ses dissections. Un bon dictionnaire est nécessaire. D’une part du grand art, de l’autre, à mon sens,... du cochon. Rien de plus. Après avoir lu Les maîtres, je n’avais plus aucune envie de lire ces romanciers. Ah si, peut-être Gunther Grass, et son si célèbre Le tambour. Non pas pour les éclairages qu’en donne Maillé – « La sexualité est-elle soluble dans la lumière ? » – mais pour le jugement porté sur ses études germaniques, évoquées dans « Le Tambour contre l’université ». Il s’agit d’une descente en règle, pas seulement du système, mais de « ses pions », entendez les professeur(e)s. Voici quelques lignes éclairantes : « Un grand professeur moderne n’a plus rien en commun avec un grand professeur d’autrefois... Il n’est plus admiré et célébré pour sa forte personnalité, son originalité brillante, sa pincée de sel inimitable... Il se juge sur un seul critère : sa «technicité». »
Que vous disais-je ? Réactionnaire. Voici mon sentiment résumé : tout ça est noir, noir, noir. Et je préfère aller vers la lumière. Qu’on a beau chercher chez les maîtres de Bruno. Quant à ce dernier, quand on le connaît, on comprend mieux.
Michel Patinaud-
ThèmeLes maîtres de l’imagination exacte